
Accueil | Introduction | Conte | Recueil d’activités | Lettre aux parents | Bibliographie et Grille d'évaluation
Panorama des réalités des enfants au pays du Bout du monde
|
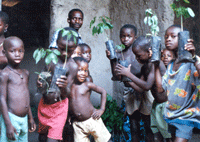 © Photo du CECI (Guinée Bissau, Afrique) |
Trois milliards d’enfants vivent sur la Terre. Ils crient, parlent, rient, courent… Qu’ils soient originaires de Québec ou de Ouagadougou, tous les enfants du monde ont besoin d’un toit, de leur famille, de nourriture, d’eau potable, de santé, de sécurité, de soins de base et d’affection. Malheureusement, nombreux sont les enfants du monde dont les besoins fondamentaux ne sont pas comblés. |
Pourquoi les disparités entre pays dits développés et pays dits en développement sont si importantes ? En quoi nos habitudes et modes de vie nous rendent-ils complices de l’accroissement des inégalités ? Quelles sont les réalités des enfants des pays dits en développement ? À quelles formes de travail sont contraints les enfants ? Jouissent-ils tous du droit d’apprendre à lire, à écrire et à compter ? Quelles sont les solutions envisageables ? |
||
LA PAUVRETÉ
« Être économiquement pauvre, c’est lutter sans cesse pour disposer du minimum vital, chercher chaque jour de quoi nourrir sa famille et, sur le long terme, être privé de tout pouvoir de décision sur sa vie : la pauvreté revient à vivre dans l’insécurité permanente et à tenter simplement d’éviter le pire1. » Les deux tiers des citoyens du monde, soit 4,4 milliards de personnes, dont 70 % sont des femmes et des enfants, vivent de façon précaire avec moins de deux dollars par jour. La plupart d’entre eux vivent dans les pays dits en développement.
Colonialisme et exploitation
La pauvreté endémique qui affecte les pays dits en développement prend sa source dans le colonialisme. La découverte des Amériques était un gage de richesse, pour les puissances coloniales (Espagne, Portugal, France et Angleterre). Pour posséder ces richesses, les colonisateurs ont décimé une bonne partie de la population indigène. Puis, jusqu’au milieu du 19e siècle, ils ont déraciné de leurs terres natales pas moins de 11 millions d’Africains pour les réduire à l’esclavage afin d’exploiter le vaste territoire conquis2. Ainsi, dès le 16e siècle, avec la force des esclaves, les colonies fournissaient du sucre aux puissances de l’Europe. Puis, des cultures de café, de cacao, de riz et d’indigo destinées principalement à l’élite européenne ont été mises en place. Au 18e siècle, c’est le coton qui a envahi les champs d’Amérique du Nord. L’exode massif d’esclaves vers l’Amérique, privant l’Afrique d’une population capable de lutter contre l’envahisseur, facilita la colonisation de ce continent, au cours des 18e et 19e siècles. Là encore, les ressources naturelles furent pillées et la population exploitée pour fournir l’Europe en denrées exotiques. Et ce pillage et cet esclavage se poursuivent encore aujourd’hui…
À titre d’exemple, les grands projets d’extraction minière dans les pays dits en développement sont principalement financés par des consortiums de multinationales dont les sièges sociaux et les actionnaires habitent les pays du Nord. Le sucre, le cacao, le café et autres produits anciennement de luxe font maintenant partie de notre alimentation courante. Leurs cultures accaparent les meilleures terres des pays dits en développement, allant jusqu’à rendre difficile la culture vivrière de laquelle dépendent les populations locales. La mondialisation néolibérale a amené quant à elle la délocalisation de la production de la majorité des vêtements, jouets, appareils électroniques et autres objets nous entourant dans les zones franches des pays dits en développement ou émergents où la main-d’œuvre coûte le moins cher et où les normes environnementales sont moins strictes, voire inexistantes.
|
Dettes
Les pays dits en développement, aux prises avec des dettes contractées principalement entre 1960 et 1980, n’arrivent pas à investir suffisamment dans les programmes sociaux (éducation, santé et filet social). « En Ouganda, par exemple, le gouvernement consacre annuellement 3 dollars par personne à la santé et à l’éducation et 17 dollars par personne au service de la dette. Un enfant ougandais sur cinq meurt avant d’avoir atteint l’âge de cinq ans3. » La somme des dettes de l’ensemble des pays dits en développement est passée de neuf millions en 1955 à plus de 370 milliards aujourd’hui4.
D’une part, le service de la dette des pays dits en développement gruge une partie considérable des budgets des États, limitant leurs moyens d’investir dans les programmes sociaux ; d’autre part, les programmes d’ajustement structurel, censés aider ces pays à rembourser leurs dettes, plongent leurs habitants dans une pauvreté extrême, en les contraignant à travailler dans des conditions toujours plus difficiles pour des salaires toujours plus maigres. Les parents, incapables de subvenir aux besoins de base de leur famille, sont, dans bien des cas, dans l’obligation de faire travailler leurs enfants. « Au Brésil, dans le seul État de Rio, 7 familles sur 10 comptent au moins partiellement sur le salaire d’un enfant5. »
|
LE TRAVAIL DES ENFANTS [HAUT DE PAGE]
De tout temps, les enfants ont travaillé. Lorsque l’espérance de vie était courte, comme au Moyen Âge, l’enfance était plus brève, et il allait de soi que l’enfant participe à l’économie familiale : jardinage, élevage, artisanat6. Au Québec par exemple, au 19e siècle, peu d’enfants fréquentaient l’école. Tandis que les enfants des campagnes travaillaient aux champs, ceux des villes exerçaient différents métiers, tels éboueurs, livreurs de journaux, ramoneurs... Avec la révolution industrielle, les usines se sont multipliées, amenant de nombreux enfants des pays aujourd’hui dits développés à travailler comme ouvriers dans des conditions pénibles7. En Europe « à la fin de la première moitié du 19e siècle, on estime qu’un ouvrier sur huit était un enfant »8.
Aujourd’hui, alors que le travail des enfants dans les pays dits développés est presque éradiqué (notons que l’Italie, le Portugal, les États-Unis et l’Angleterre comptent encore de nombreux enfants travailleurs)9, il en va tout autrement, dans les pays dits en développement, où vivent l’écrasante majorité des enfants travailleurs. En 2007, 317,4 millions d’enfants étaient économiquement actifs. Selon l’Organisation internationale du travail (OIT), à l’échelle mondiale, plus de 12 % des enfants âgés entre 5 et 9 ans travaillent ; ce chiffre atteint 23 % pour les enfants âgés de 10 à 14 ans. Plus de la moitié des enfants travailleurs vivent en Asie, où un enfant sur quatre travaille ; en Inde seulement, l’effectif des enfants travailleurs équivaut à deux fois la population du Canada10. Toutefois, c’est en Afrique que la proportion d’enfants travailleurs est la plus importante, avec un enfant sur trois11. Quant à l’Amérique latine, elle compte un enfant travailleur sur cinq.
Qu’entend-on exactement par « travail des enfants » ? Et quelles formes d’activités sont considérées comme du travail ? De manière générale, le travail des enfants fait référence à tout type de travail qui porte atteinte au développement physique, psychologique et intellectuel de l’enfant. La définition de « travail » mérite toutefois d’être nuancée. Pour Célestin Freinet, père de la pédagogie du travail qui a inspiré le renouveau pédagogique au Québec, « il y a travail toutes les fois que l’activité – physique ou intellectuelle – que ce travail suppose répond à un besoin naturel de l’individu et procure de ce fait une satisfaction, qui est par elle-même une raison d’être. Dans le cas contraire, il n’y a pas de travail, mais besogne, tâche qu’on accomplit seulement parce qu’on vous y oblige – et la chose n’est pas du tout comparable »12. Pour Bernard Schlemmer, docteur en sociologie, « tous les enfants travaillent, mais pas dans les mêmes conditions ! Ce qui les distingue, ce n’est pas le fait de savoir si l’activité de chacun mérite ou non d’être considérée comme du travail, mais le fait que ce travail est plus ou moins exploité par autrui ou investi par eux-mêmes »13. Ainsi, certaines formes de travail peuvent être bénéfiques et permettre l’émancipation des enfants. C’est ce que défend aussi le Mouvement des enfants et jeunes travailleurs (MEJT), qui souhaite que les enfants puissent continuer de travailler, mais dans la dignité et dans des conditions acceptables. D’ailleurs, « la plupart des observateurs ont remarqué que les enfants et les adolescents ne font pas qu’assurer leur survie en travaillant, mais que tous cherchent, par leur travail, à vivre avec dignité et à démontrer leur utilité sociale »14.
Formes de travail des enfants
Plus spécifiquement, le travail des enfants peut être divisé en huit grandes catégories, dont voici une brève description.
SPHÈRE FAMILIALE - Le travail dans la sphère familiale est diversifié : jardinage, élevage, transport de l’eau, recherche de bois comme combustible, préparation des repas, ménage, lavage, garde des plus jeunes. Plus la famille est grande, plus elle a besoin de bras, pour subvenir à ses besoins. De manière générale, les tâches sont réparties en fonction de l’âge et du sexe.
SECTEUR INFORMEL - Les métiers de rue, fruit de l’exode rural et de l’urbanisation, emploient plus de 500 millions de personnes dans le monde, dont 100 millions sont des enfants15. Dans certaines grandes villes, jusqu’à 60 % de la population urbaine travaille dans les rues, se débrouillant pour survivre. Pour certains pays, ils représentent une part importante de l’économie ; par exemple, les métiers de la rue représentent 25 % du PIB du Nigeria et 50 % du PIB des Philippines16. Voici quelques exemples de métiers de rue : gardien de voitures, vendeur ambulant (bonbons, cigarettes, ustensiles...), mendiant, cireur de chaussures, laveur de fenêtres, guide touristique, porteur d’eau...
TRAVAIL DOMESTIQUE - Il s’agit de la forme la plus cachée de travail des enfants, qui emploie principalement des filles. Ces petites bonnes issues d’un milieu pauvre travaillent comme domestiques dans des familles riches. Elles se comptent par millions dans le monde ; seulement en Amérique centrale, elles seraient près de 250 00017.
INDUSTRIE ET ARTISANAT - Il s’agit de la forme la plus connue de travail des enfants, qui concerne 25 % à 30 % des enfants travailleurs. Ces enfants travaillent dans presque tous les domaines (mines, carrières, industries manufacturières et ateliers artisanaux). Ils font face à des conditions éprouvantes (horaires longs, punitions et cadence imposée) et bien souvent dangereuses (manipulation de produits toxiques, transport de lourdes charges, inhalation d’air vicié…). L’emploi en sous-traitance pour des multinationales (vêtements, articles de sport, jouets...) implique environ 10 % des enfants travailleurs (30 millions d’enfants). La dispersion résultant d’une production reposant sur une multitude de petits sous-traitants (entreprises, ateliers, employés à domicile) rend le travail d’enfants facile à cacher18. L’industrie minière emploie également de nombreux enfants aux quatre coins du monde. L’industrie diamantaire indienne, par exemple, qui fournit 70 % de la demande internationale en diamants, repose sur la main-d’œuvre enfantine19. « Une bonne partie des milliers de petites mines d’Amérique latine sont exploitées de façon précaire, parfois sans licence d’exploitation, et quasiment toutes emploient des enfants.20 » Selon le Bureau international du travail (BIT), ils sont plus de 150 000 dans les mines du Pérou, de la Bolivie et de l’Équateur. Les « enfants-taupes », comme ils sont couramment surnommés, de petite taille, ont l’avantage de pouvoir entrer dans d’étroits tunnels ; ils travaillent souvent sans équipement de sécurité dans des conditions éprouvantes.
AGRICULTURE - Plus de 40 % de la main-d'œuvre enfantine travaille dans l’agriculture. « Que ce soit d’activités comme garder le bétail, récolter les céréales, entretenir les machines, guider des avions avec des drapeaux ou épandre des pesticides, plus de 132 millions de filles et de garçons âgés de 5 à 14 ans aident à la production de nourriture et de boissons que nous consommons, ainsi que de fibres et autres matériaux agricoles que nous utilisons21. » Les enfants sont employés en très bas âge, dans les cultures d’exportation : canne à sucre, café, cacao, caoutchouc (hévéas), tabac… Dans certains pays, comme le Kenya, le Mexique et le Brésil, 20 à 30 % des employés des plantations ont moins de 15 ans22. De plus, dès l’âge de cinq ou six ans, les enfants aident leurs parents à cultiver les champs, puis à vendre leurs produits au marché.
EXPLOITATION SEXUELLE - L’exploitation sexuelle, bien qu’elle soit plus répandue en Asie, qui compte un million d’enfants livrés à la prostitution, n’épargne aucun continent. Ce phénomène a d’ailleurs pris de l’ampleur au cours de la dernière décennie, à cause de l’idée fausse que les enfants seraient moins infectés par le sida que les adultes23.
SERVITUDE POUR DETTE - Il s’agit de la forme d’esclavage la plus répandue, qui touche 10 millions d’enfants en Inde et 7 millions d’enfants au Pakistan. La servitude pour dette provient d’un endettement du travailleur envers son employeur. Le travailleur gagnant un salaire de misère n’arrive pas à rembourser sa dette, qui va en s’accroissant avec les amendes que lui impose l’employeur pour outil brisé ou travail insatisfaisant24.
ENFANT-SOLDAT - « Le nombre d’enfants engagés dans des conflits armés a fortement progressé, au cours de la dernière décennie. En 2001, selon les estimations de l’OIT, environ 300 000 enfants étaient enrôlés dans les unités armées à l’échelon mondial (dont 120 000 en Afrique, 120 000 en Asie et au Pacifique et 30 000 en Amérique latine et aux Caraïbes)25. »
Causes et conséquences du travail des enfants
La pauvreté est sans aucun doute la première cause du travail des enfants. « Lorsqu’une famille vit dans une misère extrême, les revenus, même dérisoires, que rapportent les enfants peuvent être indispensables à sa survie26. » La recherche constante des coûts de production les plus bas, couplée aux dettes des pays dits en développement entretenue indéfiniment par le bas prix de leurs exportations, mobilise ces pays au service des pays riches. Et les enfants, qui constituent la main-d’œuvre la moins coûteuse, sont abandonnés au bénéfice des entrepreneurs et des actionnaires (incluant nos fonds de retraite). Toutes les études arrivent à la même conclusion : l’emploi d’enfants ne vient aucunement combler un manque de main-d’œuvre. Le nombre de chômeurs adultes est partout équivalent ou supérieur au nombre d’enfants travailleurs. L’emploi d’enfants a pour effet d’entraîner une baisse de salaire de l’ensemble des salariés.
Bien que certaines formes de travail puissent s’avérer émancipatrices pour les enfants, dans bien des cas le travail infantile prive les enfants de leur enfance. Ils sont majoritairement exploités économiquement, percevant les plus bas salaires, voire aucun. Les enfants sont souvent contraints à travailler de longues heures dans des conditions entraînant des déformations physiques et des problèmes de santé à court, moyen ou long terme, sans parler des séquelles psychologiques. Mais encore, le travail des enfants, en faisant obstacle à l’éducation, perpétue la pauvreté et compromet les possibilités d’obtenir, à l’âge adulte, un emploi plus rémunérateur.
L’ÉDUCATION [Haut de page]
L’Unicef estime que 400 millions d’enfants ne sont pas scolarisés27. C’est dans les pays dits en développement que le nombre d’enfants fréquentant l’école est le plus bas : en Afghanistan, un enfant sur cinq va à l’école, tandis qu’au Mali, cette proportion est réduite à un enfant sur sept28. L’échec de la scolarisation universelle renvoie au manque de moyens financiers pour l’éducation. D’abord, dans la majorité des pays dits en développement, le nombre d’écoles est insuffisant, pour accueillir la concentration d’enfants dans les villes en pleine expansion et pour rejoindre les enfants dispersés en région rurale. Les classes se retrouvent trop souvent surchargées ; les locaux sont exigus, délabrés et mal protégés des intempéries ; le matériel est insuffisant, voire absent ; les programmes ne sont pas adaptés ; et les enseignants sont sous-payés et démotivés. «L’organisation Éducation internationale (qui regroupe 310 syndicats enseignants dans le monde) estime que 70 % des 50 millions d’enseignants sont pauvres.29 » Ceci peut expliquer qu’à l’échelle de la planète, seulement un enfant scolarisé sur trois achève son primaire30. De plus, non seulement l’école coûte cher (uniformes, livres...), mais elle occasionne un manque à gagner, pour les familles pauvres. D’une part, l’enfant à l’école ne rapporte pas d’argent. D’autre part, dans de nombreux pays dits en développement, l’obtention d’un diplôme amène peu de débouchés ; le plus courant est celui de fonctionnaire, dont les perspectives d’emploi, depuis la mise en place des PAS, sont de plus en plus réduites31.
Parmi tous les enfants, ce sont les filles qui sont le moins scolarisées. De manière générale, pour 100 garçons qui ne fréquentent pas l’école primaire, on compte 117 filles non scolarisées. Puisque dans bien des cultures, principalement en Afrique et en Inde, les filles sont vouées, par le mariage en bas âge, à appartenir à une autre famille, il vaut mieux investir dans l’éducation des garçons, qui, eux, continueront à faire fructifier le maigre patrimoine familial32. Au Bénin, par exemple, 66 % des filles ne vont pas à l’école, contre 30 % des garçons33. Toutefois, pour l’ensemble des pays dits en développement, le taux d’enfants inscrits à l’école a augmenté de 8 % en près de vingt ans. Selon les données des Nations unies, 88 % des enfants des pays dits en développement fréquentaient l’école, en 2007.
Afin d’améliorer la situation de l’éducation dans le monde, les 192 pays membres de l’Organisation des Nations unies (ONU) ont convenu d’assurer l’éducation primaire pour tous d’ici 2015, et ce, dans le cadre des Objectifs du millénaire pour le développement. Des organismes de coopération internationale ainsi que des ONG locales se mobilisent et mettent sur pied différents projets visant à améliorer l’accessibilité et la qualité de l’éducation dans les pays dits en développement. À titre d’exemples, citons :
- le FAWE (Forum des éducatrices africaines). Il s’agit d’une organisation de femmes africaines ayant occupé des postes importants dans les ministères de l’Éducation de différents pays d’Afrique qui offre des cours du soir destinés aux petites bonnes dans les grandes villes de 25 pays africains34 ;
- le programme Uniterra35 envoie des coopérants canadiens au Ghana, au Niger, au Sénégal et au Vietnam pour travailler avec les ONG locales à améliorer l’éducation formelle et non formelle et à augmenter la fréquentation scolaire ;
- le Centre d’études et de coopération internationale (CECI) a organisé le Forum de Niamey sur l’éducation non formelle, contribuant à réaffirmer l’importance de soutenir les projets et programmes d’alphabétisation au Niger comme dans l’ensemble des pays africains.
Notons aussi que dans la foulée des Objectifs du millénaire pour le développement, le Kenya, la Tanzanie, l’Ouganda et bien d’autres pays dits en développement ont aboli les frais d’inscription dans leurs écoles primaires, entraînant une augmentation spectaculaire de la fréquentation scolaire en l’espace de quelques années.
LES SOLUTIONS [Haut de page]
Atténuation de la pauvreté et éducation universelle
Comme cela a été mentionné précédemment, les gouvernements de la plupart des pays dits en développement ont les poings liés par une dette qui ne cesse de s’accroître36, limitant leurs investissements dans l’éducation pour la rendre accessible. Certaines initiatives ont amené la réduction, voire l’annulation de la dette des pays les plus endettés37 ; cependant, l’effort est insuffisant.
Une récente étude estime qu’il faudrait investir 16 milliards de dollars canadiens annuellement, et ce, jusqu’en 2015, pour rendre l’éducation universelle. Cette somme peut paraître gigantesque, mais mettons-la en perspective. Selon des données recueillies par le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), les Européens avaient dépensé 11 milliards de dollars en crème glacée, 50 milliards de dollars en cigarettes et 105 milliards de dollars en boissons alcoolisées, pour l’unique année 1998. Au cours de cette même année, en Europe et aux États-Unis, 12 milliards de dollars avaient été dépensés en parfum et 17 milliards en nourriture pour animaux domestiques38. En 2004, les dépenses militaires mondiales s’élevaient quant à elles à 1 000 milliards de dollars.
Par ailleurs, l’ONU a établi que les pays industrialisés doivent consacrer 0,7 % de leur PIB à l’aide au développement. Seuls quatre pays, la Norvège, le Danemark, la Suède et les Pays-Bas, ont respecté ce pourcentage. Quant au Canada, il y investissait, en 2005, 0,34 % de son PIB39.
Toutes les stratégies contribuant à alléger la pauvreté, qu’elles relèvent de la macroéconomie (annulation de la dette, augmentation des prix des matières premières exportées par les pays dits en développement, réaménagement des programmes d’ajustement structurel pour fournir des filets sociaux aux plus démunis…) ou de la microéconomie (microcrédit, projets permettant aux femmes de développer une autonomie financière…), améliorent la situation des enfants dans le monde et contribuent, à terme, à éradiquer le travail des enfants dans des conditions indignes.
Conventions et lois
Les différentes législations nationales et internationales ont assurément des conséquences positives, en regard du traitement des enfants et de leurs conditions de vie. L’Organisation internationale du travail (OIT), créée en 1919, avait adopté dès sa première session une convention sur l’âge minimum de travail des enfants fixé à l’époque à 14 ans. Ces différentes conventions ont amené plusieurs pays à modifier leur façon de faire à l’égard des enfants. Le Sri Lanka, par exemple, a interdit aux jeunes de moins de 18 ans de s’engager dans l’armée, tandis que le Bangladesh a rendu l’école primaire obligatoire pour les filles40.
Le Forum mondial sur l’éducation, qui s’est tenu à Dakar, en 2000, a amené les gouvernements à réaffirmer leur engagement à faire en sorte que d’ici 2015, « tous les enfants, notamment les filles, aient la possibilité d’accéder à un enseignement primaire, obligatoire et gratuit, de qualité et [que] les pays donateurs et institutions promettent qu’aucun pays réellement désireux d’atteindre les objectifs de l’éducation pour tous ne devrait voir son action entravée par le manque de ressources»41.
|
Organisations des enfants travailleurs
Les enfants travailleurs des quatre coins du monde42 se sont rassemblés au Sommet mondial des enfants travailleurs tenu à Kundapur en 1996 et ont rédigé une déclaration. Partant du constat que travailler est une réalité économique pour des millions d’enfants dans le monde, les enfants travailleurs revendiquent de la dignité dans le travail et des conditions décentes. La mobilisation des enfants travailleurs a amené les autorités et organismes de défense à les considérer comme des acteurs sociaux, des citoyens et des travailleurs ayant des droits, plutôt que comme des victimes (ce qu’ils sont aussi trop souvent). Le Bureau international du travail (BIT) a décidé, depuis 2001, de ne plus lancer de programmes destinés aux enfants travailleurs sans consulter les enfants concernés.
De manière générale, les enfants travailleurs nous disent, à travers la Déclaration de Kundapur, qu’il est assurément important de tenter de régler le problème spécifique du travail des enfants, mais que cela n’est guère suffisant. Il faut remettre en question le système économique actuel, qui « traite le travailleur comme une ressource, et non comme un homme au service de qui penser l’économie » 43, et se mobiliser contre lui.
|
|
Sensibilisation et actions d’ONG sur le terrain
Plusieurs actions sont menées par des organisations internationales, des organismes de coopération internationale et des ONG locales, pour améliorer la situation des enfants dans le monde. Puisque la scolarisation est l’une des clés permettant aux enfants de sortir du cercle vicieux de la pauvreté, des milliers de projets sont nés, pour adapter l’école aux besoins des enfants et la rendre accessible (écoles du soir, écoles dans la rue, écoles sous des arbres en Afrique, écoles de fortune dans les briqueteries de l’Inde, classes dans les ateliers de tapis au Pakistan et au Maroc, classes au bord des mines en Amérique latine, écoles flottantes au Cambodge…). Par exemple, la Fondation Paul Gérin-Lajoie œuvre depuis trente ans en Afrique de l’Ouest et à Haïti à l’amélioration de la qualité de l’enseignement et à faciliter l’accès à l’école. Depuis, de nombreux projets ont été réalisés, telle la construction d’une pirogue scolaire dans la commune de Grand-Popo, au Bénin, permettant aux enfants de traverser la rivière pour se rendre à l’école.
|
En ce qui concerne le travail des enfants, les différents organismes adoptent des positions divergentes ; certains sont pour l’abolition du travail des enfants dans le monde, affirmant que la place des enfants est à l’école, et optent pour la répression des employeurs, d’autres (représentés surtout par les ONG de terrain) pensent que l’abolition est une vision occidentale et que dans les conditions de sous-développement actuelles, on ne peut interdire aux enfants de gagner des sous. Malgré ces divergences d’opinions, différentes actions sont menées par ces ONG pour améliorer la qualité de vie des enfants travailleurs. Par exemple, citons l’organisme de coopération internationale canadien SUCO, qui travaille en partenariat avec l’Instituto de Promotiòn Humana (INPRHU) du Nicaragua à la directiòn du Programa de atencion a los niños trabajadores (PANT). Le PANT travaille à la défense des droits des enfants travailleurs et appuie des actions visant à augmenter leur accès à l’éducation et à la santé.
Le malheur est que la Terre est unique et que sa capacité de support est limitée. |
Force est de constater que les richesses des pays dits développés reposent en grande partie sur l’exploitation des ressources naturelles et humaines des pays dits en développement, et ce, depuis plusieurs siècles. Alors que nous vivons dans l’opulence et la surconsommation, les deux tiers des humains vivent avec moins de deux dollars par jour. La pauvreté extrême à laquelle sont confrontés des centaines de millions d’enfants dans le monde les oblige à travailler. « Tous les produits de la vie quotidienne portent en eux une part de travail des enfants. Il est impossible de dresser la liste exhaustive des biens et aliments entachés par le travail d’enfants, tant elle est longue ; souvent, les enfants n’interviennent qu’à un stade de la fabrication.44 » |
Devant ces constats, il nous faut inventer une autre manière de vivre ensemble sur la Terre, nous amenant à partager les richesses et la dignité. Pour ce faire, tentons, avec les élèves, de questionner nos modes de vie et de comprendre comment ils affectent l’ensemble des enfants et citoyens du monde. Puis, tentons de repenser nos façons de vivre, de transformer nos comportements et habitudes de vie et de nous investir pour construire un monde juste, convivial, soutenable et solidaire.
Notes : [Haut de page]
1 Bénédicte MANIER, Le travail des enfants dans le monde, Paris, Éditions La Découverte, 2003, p. 64.
2 Christian RIOUX, « L’histoire prise en otage », Le Devoir, 14 et 15 janvier 2006.
3 Craig KIELBURGER, Libérez les enfants !, Montréal, Les Éditions Écosociété, 1999, p. 376.
4 Gil COURTEMANCHE, « Journal de Bretagne », Le Devoir, 9 et 10 juillet 2005.
5 Bénédicte MANIER, Le travail des enfants dans le monde, Paris, Éditions La Découverte, 2003, p. 64.
6 Sigrid BAFFERT, Ces ouvriers aux dents de lait, Paris, Éditions La Découverte et Syros, 2001, p. 116.
7 Au Québec, les principales industries employant des enfants étaient celles du textile, du cuir, du tabac et du vêtement.
8 Martin MONESTIER, Les enfants esclaves : L’enfer quotidien de 300 millions d’enfants, Paris, Le cherche midi, 1998, p. 24.
9 « Plus de 300 000 enfants n’ayant pas l’âge légal d’admission à l’emploi travaillent illégalement, aux États-Unis, dont plus de la moitié dans l’agriculture commerciale (Boston Globe, 17 mai 2000). Au Portugal, plus de 35 000 enfants âgés de 6 à 14 ans sont économiquement actifs et près de 40 % d’entre eux travaillent six ou sept jours par semaine (SIETI, 2001). En Italie, 145 000 enfants de 7 à 14 ans ont déjà une expérience professionnelle (ISTAT, 2002) ». Janet HILOWITZ, Joost KOOIJMANS, Peter MATZ, Peter DORMAN, Michaelle DE KOCK et Muriel ALECTUS, Le travail des enfants : Un manuel à l’usage des étudiants, Turin, Organisation internationale du travail, 2004, p. 34.
10 Claire BRISSET, « Le travail des enfants », Problèmes politiques et sociaux, no 839, 26 mai 2000, p. 3.
11 « Au Mali et au Burkina Faso, 50 % des enfants travaillent, tandis qu’au Niger et en Sierra Leone, ce taux atteint 70 %. » Bénédicte MANIER, Le travail des enfants dans le monde, Paris, Éditions La Découverte, 2003, p. 43.
12 Célestin FREINET, « Les dits de Mathieu », Œuvres pédagogiques 1, Paris, Éditions du Seuil, 1994, p. 230.
13 (Bernard SCHLEMMER, L’enfant exploité : Oppression, mise au travail et prolétarisation, Paris, Khartala-ORSTOM, 1996, p. 24.) ; cité par Michel BONNET, Karl HANSON, Marie-France LANGE, Graciela PAILLET, Olga NIEUWENHUYS et Bernard SCHLEMMER, Enfants travailleurs repenser l’enfance, Lausanne, Éditions Page deux, 2006, p. 181.
14 REPER, [En ligne], [http://www.enfants-des-rues.com/pages/fr/thematiques_travail.asp].
15 Sigrid BAFFERT, Ces ouvriers aux dents de lait, Paris, Éditions La Découverte et Syros, 2001, p. 119.
16 Bénédicte MANIER, Le travail des enfants dans le monde, Paris, Éditions La Découverte, 2003, p. 25.
17 Ibid., p. 66.
18 Ibid., p. 87. « Les entreprises recrutant une main-d’œuvre enfantine sont généralement de petite taille et elles agissent en qualité de sous-traitants d’entreprises plus grandes. Elles fonctionnent souvent sur un mode informel, ont une durée de vie limitée et ne sont pas enregistrées. » Janet HILOWITZ, Joost KOOIJMANS, Peter MATZ, Peter DORMAN, Michaelle DE KOCK et Muriel ALECTUS, Le travail des enfants : Un manuel à l’usage des étudiants, Turin, Organisation internationale du travail, 2004, p. 47.
19 Bénédicte MANIER, Le travail des enfants dans le monde, Paris, Éditions La Découverte, 2003, p. 66.
20 Ibid., p. 68.
21 Programme international pour l’abolition du travail des enfants (OIT), [En ligne], [http://www.ilo.org/ipec/programme/lang--fr/index.htm].
22 Bénédicte MANIER, Le travail des enfants dans le monde, Paris, Éditions La Découverte, 2003, p. 28.
23 Sigrid BAFFERT, Ces ouvriers aux dents de lait, Paris, Éditions La Découverte et Syros, 2001, p. 123.
24 Alain SERRE, Le grand livre des droits de l’enfant, éditions Rue du Monde, 1999, p. 24.
25 Programme international pour l’abolition du travail des enfants (OIT), [En ligne], [http://www.ilo.org/ipec/programme/lang--fr/index.htm].
26 Claire BRISSET, « Le travail des enfants », Problèmes politiques et sociaux, no 839, 26 mai 2000, p. 43.
27 UNICEF, [En ligne], [www.unicef.ca].
28 Alain SERRE, Le grand livre des droits de l’enfant, éditions Rue du Monde, 1999, p. 37.
29 Bénédicte MANIER, Le travail des enfants dans le monde, Paris, Éditions La Découverte, 2003, p. 37.
30 Ibid., p.41.
32 Claire BRISSET, « Le travail des enfants », Problèmes politiques et sociaux, noo 839, 26 mai 2000, p. 47.
32 Ibid., p.41.
33 Alain SERRE, Le grand livre des droits de l’enfant, éditions Rue du Monde, 1999, p. 37.
34 Michel BONNET, Karl HANSON, Marie-France LANGE, Graciela PAILLET, Olga NIEUWENHUYS et Bernard SCHLEMMER, Enfants travailleurs repenser l’enfance, Lausanne, Éditions Page deux, 2006, p. 150.
35 Le programme Uniterra résulte d’un partenariat entre le Centre d’études et de coopération internationale (CECI) et l’Entraide universitaire mondiale du Canada (EUMC).
36 La Tanzanie consacre 50 % de son budget au service de la dette, cependant, dans la foulée des Objectifs du millénaire pour le développement, ce même pays a aboli les frais d’inscription dans ses écoles primaires.
37 En juillet 2005, au sommet du G8 à Gleneagles, a été lancée l'Initiative multilatérale d'annulation de la dette qui permet l'annulation des dettes contractées auprès du FMI, de la BM et de la Banque de développement africaine par 18 pays pauvres très endettés. Pour ce faire, les pays dits développés ont investi 40 milliards de dollars. Cependant, afin d'annuler totalement les dettes des 42 pays pauvres très endettés, il faudrait consentir un investissement de 180 milliards de dollars. Notons que le monde compte 165 pays dits en développement et que la population des 42 pays pauvres très endettés représente seulement 11 % de la population totale des pays dits en développement.
38 PNUD, Rapport mondial sur le développement humain 1998 ; cité par Janet HILOWITZ, Joost KOOIJMANS, Peter MATZ, Peter DORMAN, Michaelle DE KOCK et Muriel ALECTUS, Le travail des enfants : Un manuel à l’usage des étudiants, Turin, Organisation internationale du travail, 2004, p. 135.
39 SECRÉTARIAT DU CONSEIL DU TRÉSOR DU CANADA, [En ligne], [http://www.tbs-sct.gc.ca/report/govrev/06/ann303_f.asp].
40 Michel BONNET, Karl HANSON, Marie-France LANGE, Graciela PAILLET, Olga NIEUWENHUYS et Bernard SCHLEMMER, Enfants travailleurs : Repenser l’enfance, Lausanne, Éditions Page deux, 2006, p. 12.
41 Janet HILOWITZ, Joost KOOIJMANS, Peter MATZ, Peter DORMAN, Michaelle DE KOCK et Muriel ALECTUS, Le travail des enfants : Un manuel à l’usage des étudiants, Turin, Organisation internationale du travail, 2004, p. 218.
42 MOUVEMENT AFRICAIN DES ENFANTS ET JEUNES TRAVAILLEURS (MAEJT) en Afrique, BUTTERFLIES en Inde, NINOS Y ADOLECENTES TRABAJADORES (NATs) en Amérique latine et dans les Caraïbes.
43 Michel BONNET, Karl HANSON, Marie-France LANGE, Graciela PAILLET, Olga NIEUWENHUYS et Bernard SCHLEMMER, Enfants travailleurs : Repenser l’enfance, Lausanne, Éditions Page deux, 2006, p. 19.
44 Bénédicte MANIER, Le travail des enfants dans le monde, Paris, Éditions La Découverte, 2003, p. 104.
[Pour télécharger Panorama des réalités des enfants au pays du Bout du monde en format pdf]
 © Photo du CECI Karine Guidicelli (Tadjikistan, Asie)
© Photo du CECI Karine Guidicelli (Tadjikistan, Asie)